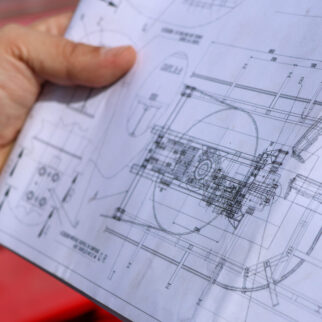Gron : coulisses d’un télésiège reconditionné
Le 10 avril 2025, le télésiège de Gron a transporté les derniers skieurs vers le sommet des pistes. En fin de journée, l’arrêt de l’appareil était définitif. C’est d’ailleurs avec une certaine nostalgie que les équipes du domaine skiable ont vécu cet instant. Il faut dire que ce vieux « pépère » est emblématique. Inauguré à Noël 1998, il détient un beau palmarès : 26 hivers en service, 24 000 heures de fonctionnement et 15,5 millions de passagers transportés, soit l’équivalent de la ville de Los Angeles. Autant dire que la retraite est bien méritée… Et pourtant, l’histoire ne s’arrête pas là ! Avec son remplacement, c’est une nouvelle aventure qui commence car pour lui succéder, ce n’est pas un appareil neuf qui a été choisi, mais un télésiège « reconditionné », soigneusement sélectionné et préparé pour sa nouvelle vie dans la combe de Gron.
Aux Carroz, l’économie circulaire s’invite dans tous les secteurs, même dans les remontées mécaniques. Un choix vertueux sur tous les plans – éthique, écologique et économique – qui méritent quelques explications à lire dans cet article. Mais avant de pouvoir embarquer à nouveau, il y a tout un chantier à orchestrer. À travers une série de photos inédites et de reportages vidéo, nous avons décidé de vous faire vivre, au plus près du terrain, les coulisses de ce chantier d’envergure… Car faire renaître un télésiège ailleurs, c’est tout un défi.
LA GENÈSE DU PROJET
Oui, vous avez bien lu : un télésiège ayant déjà servi ailleurs, remis à neuf avec soin, va bientôt prendre le relais pour transporter les skieurs. Si cette année est dédiée aux travaux en vue de l’ouverture pour Noël 2025, ce projet a vu le jour bien avant, il y a six ans déjà.
Le postulat de départ
En 2019, le domaine skiable réfléchit aux investissements à venir sur les prochaines années. L’intention est la suivante : moderniser certains appareils existants, tout en préservant la capacité à financer d’autres projets d’envergure. Comme le dit le proverbe, « choisir, c’est renoncer ». Mais à cet instant précis, ce n’était pas une option pour garder de l’ambition. C’est alors que l’alternative d’un télésiège d’occasion s’est imposée comme la seule approche pragmatique.
Le marché de l’occasion
Il fallait oser. Dans le contexte de l’époque, la filière de l’occasion n’était clairement pas le réflexe pour renouveler un télésiège. Les stations recyclaient parfois en interne, mais elles n’allaient pas chercher des solutions ailleurs. Et ce pour plusieurs raisons. Déjà, la sensibilisation en faveur du recyclage n’était pas aussi présente, et la notion de « réutiliser » plutôt que de « jeter » ne suscitait pas une prise de conscience aussi forte. En parallèle, l’inflation n’était pas encore passée par là. L’écart de prix était inférieur à 10%, ce qui rendait l’achat d’occasion peu compétitif. De toute façon, les remontées mécaniques récentes, en bon état, étaient peu disponibles à la revente. Cette rareté créait donc un cercle vicieux peu favorable à l’émergence d’un marché où l’offre et la demande pouvait se rencontrer. Et puis, trouver un télésiège d’occasion adapté à ses propres contraintes d’implantation représentait un véritable défi, et pouvait donc décourager. Pour le coup, cette difficulté est toujours vraie aujourd’hui.
La complexité technique
Dans les faits, la construction d’une remontée mécanique nécessite des calculs méthodiques, en lien avec de nombreuses données topographiques : l’absorption de la pente, la définition d’un tracé, la vérification de l’état des sols, etc. Lors de la construction d’un télésiège neuf, ces éléments sont intégrés à partir d’une page blanche, sur laquelle se dessine les esquisses d’un projet sur-mesure. A l’inverse, réimplanter un télésiège ne permet pas de partir de zéro. C’est en ce point que la mission s’avère plus délicate. Il faut trouver chaussure à son pied. Plus concrètement, aux Carroz, il a fallu trouver l’appareil qui réussissait la prouesse de s’adapter au territoire de la combe de Gron, après avoir rendu de loyaux services dans sa station d’origine.
La recherche du télésiège
C’est là que vous vous demandez comment la recherche s’est organisée. Trouver un télésiège d’occasion, ce n’est pas exactement comme chiner une table basse sur Leboncoin. Pas d’annonce du style « vend télésiège, bon état, peu servi ». Ici tout se joue dans les coulisses du petit monde des remontées mécaniques. La quête du bon modèle ressemble à une chasse au trésor. Il faut scruter les démontages prévus dans d’autres stations, rester à l’affût des projets de modernisation, contacter les constructeurs, avoir quelques sources secrètes et surtout… être au bon endroit au bon moment. Entre les exigences techniques, le délai et le budget à respecter, chaque piste explorée peut vite tourner à la fausse bonne idée. Mais parfois, avec un peu de patience et de réseau, la bonne opportunité finit par apparaître — celle qui coche toutes les cases, et qui donne enfin le feu vert au projet.
Le télésiège idéal avait précisément les critères suivants : la capacité à absorber 400m de dénivelé et 1,5km de longueur, tout en ayant un débit conséquent et peu d’heures de fonctionnement. La recherche devait se faire exclusivement en France, assurant la certification européenne de l’appareil (et donc que les composants répondent à certaines normes). Une première occasion se présente en 2018, avec un télésiège débrayable 4 places. La faisabilité technique est convaincante mais au fil des investigations, l’appareil présente une usure prématurée. Pas une si bonne affaire finalement. Retour à la case départ. Une seconde possibilité est envisagée à Val Thorens, avec un télésiège similaire, mais elle est vite abandonnée en raison de la disponibilité et de complexités administratives.
Début 2022, après deux années de recherches infructueuses, l’espoir renaît du côté des Pyrénées. Le télésiège débrayable 6 places des « Mouscades », exclu des futurs aménagements de la station de Saint-Lary, est promis à la déconstruction. La suite s’enchaîne : recherches poussées, projections d’implantation, repérage de terrain. C’est une bonne surprise. L’appareil présente un nombre dérisoire d’heure de fonctionnement, en plus d’un excellent état général. Les discussions s’entament pour l’acquisition, avec en parallèle la commande d’une étude de faisabilité auprès d’un cabinet spécialisé. C’est confirmé : les planètes s’alignent, comme une chance qu’il ne faut pas laisser passer. Cette opportunité concrétisée, il est temps de repenser le tracé pour optimiser la future desserte sur le domaine skiable.
Le nouveau tracé
L’embarquement se fera toujours au même endroit, mais la montée mènera désormais vers un tout autre cap, juste en face de la gare d’arrivée du télésiège des Molliets. Cette nouvelle configuration facilitera nettement la liaison vers la station voisine de Morillon. Et surtout, c’est l’occasion de (re)découvrir la combe de Gron. Ce secteur, le plus riche en pistes aux Carroz et idéalement exposé, est méconnu. Pourtant, son enneigement est excellent et les pistes sont taillées pour le plaisir. Grâce au nouveau télésiège, il ne reste qu’à savourer tout son potentiel.
Le reconditionnement
C’est le sujet au cœur du projet. Après avoir exploré quelques particularités, il est temps de se pencher sur la dynamique principale : l’’utilisation d’un télésiège en réemploi. Cette décision, loin d’être anodine, répond à des enjeux clés – économiques, environnementaux et techniques. Elle marque également une avancée concrète en matière de gestion durable.
Côté budget, quelques chiffres suffisent à mesurer l’intérêt de cette approche. Le coût d’un équipement neuf équivalent est estimé à 10 millions d’euros. Grâce au reconditionnement, la facture est allégée d’environ 30%. Et si le pourcentage n’impressionne pas, il suffit pourtant de se rappeler que ce sont bien de millions d’euros d’économie dont il est question.
Mais c’est sur le plan environnemental que les bénéfices apparaissent les plus marquants.
Le reconditionnement permet de prolonger la vie de matériaux parfaitement fonctionnels, évitant ainsi leur mise au rebut prématurée. Résultat : une diminution significative de la consommation de nouvelles ressources et une baisse directe de l’empreinte carbone. Concrètement, en réutilisant des composants majeurs comme le moteur, le réducteur, les gares, les balanciers et les pylônes, l’utilisation de matières premières est réduite de 80/90%, et les émissions de gaz à effet de serre sont diminuées d’un facteur dix par rapport à un projet neuf.
Sur le plan technique et sécurité – puisque la question peut se poser – chaque composant réemployé est rigoureusement contrôlé, testé et révisé selon des normes strictes. Sur l’ensemble du projet, seuls 15 à 20% des éléments sont neufs, principalement des pièces comme le câble, l’appareillage électrique, la boulonnerie, les véhicules. De quoi garantir la performance et le confort. D’ailleurs, pour les skieurs, il y a une bonne nouvelle : le nouveau télésiège de Gron sera plus rapide, plus silencieux et plus fluide. Et entre nous, bonne chance à ceux qui essaieront de deviner qu’il a déjà une première vie derrière lui ! Un bel exemple d’innovation discrète au service de la durabilité. Maintenant, il est temps de passer de la théorie à la pratique.
les coulisses du chantier
ÉTAPE 1 : DÉMONTAGE DE L’ANCIEN TÉLÉSIÈGE DE GRON
Avant de laisser place à un appareil plus moderne, l’ancien télésiège doit être entièrement démonté. La première étape consiste à retirer tous les sièges encore pendus sur la ligne. Ils seront stockés au sol durant le reste des opérations. Une fois la ligne dégagée, il est alors possible de procéder à la découpe du câble. Voilà une opération impressionnante qui marque symboliquement la fin de vie du télésiège. Couper un câble de remontée mécanique ne s’improvise pas… Composé d’un ensemble de brins métalliques appelés « torons » tressés méticuleusement entre eux, cette véritable colonne vertébrale d’acier est conçue pour encaisser une charge colossale (32 tonnes pour Gron). Pour le sectionner, le chalumeau entre en scène, découpant chaque brin un par un tandis que le câble est toujours suspendu entre les pylônes. Au moment précis où le dernier toron cède, la tension accumulée dans le câble est libérée. Le métal ne se rompt pas sans réagir : il tressaille, tremble, bouge parfois même brusquement. Cette étape critique nécessite donc une vigilance toute particulière et une mise en sécurité des intervenants. Les opérations se poursuivent avec le démontage des équipements majeurs : les pylônes et les gares. Les équipes de la STM PUGNAT – expertes des travaux en montagne – sont aux commandes. Les géants d’acier sont déboulonnés et sont déposés au sol à l’aide d’engins spéciaux. Il faut s’imaginer les colonnes de métal s’effondrer avec une facilité déconcertante, comme un château de cartes effleuré du bout des doigts. Une fois à terre, un nouveau processus peut commencer. L’entreprise de ferraillage prend le relais, en triant soigneusement les matériaux afin de garantir la valorisation et le recyclage des déchets. Là aussi, l’acier finit par se déchirer en petits morceaux, comme du papier, sous la poigne de la cisaille hydraulique. Et pour les quelques éclats égarés au sol ou enfuis malencontreusement, un aimant géant est fixé à la place de la pince, permettant de récupérer tous les derniers fragments. L’idée étant de tourner la page de l’ancien télésiège « proprement ». Au total, une dizaine de jours auront été nécessaires pour finaliser les étapes de démontage.
ÉTAPE 2 : HÉLIPORTAGE DES ÉQUIPEMENTS
Il est des jours où le génie humain ne suffit pas. Où même les machines de chantier les plus robustes doivent s’effacer devant des monstres d’acier capables de défier la gravité. Dans les hauteurs des Carroz, sur le chantier du nouveau télésiège, ce jour était arrivé. Pour permettre à l’avancée des travaux, les équipes avaient un rendez-vous immanquable avec un Super Puma AS 332. Pas un simple hélicoptère. Une bête volante, conçue pour rendre possible l’impossible. Un modèle de plus de 4 tonnes à vide, capable de lever plus que son propre poids, et dont l’un des frères jumeaux encore plus costaud est utilisé dans l’aviation militaire. En bref, un engin de l’extrême, de ceux qui font rêver les enfants comme les plus grands, et qui suscitent même des vocations.
Là-haut, dans le silence des cimes, le bruit de ses pales annonçait une opération à la précision chirurgicale : 22 rotations et aucun droit à l’erreur. Au sol, tout était prêt depuis quelques jours. Chaque pylône, chaque tête de pylône, chaque balancier, avait été sécurisé et élingué. L’improvisation n’a pas sa place quand la puissance de l’hélicoptère est à l’œuvre. Il en va de la sécurité des hommes, et de la réussite de cette manœuvre millimétrée. Autre anticipation : les fondations attendaient déjà depuis plusieurs semaines. Coulées au béton, elles étaient prêtes à accueillir chaque mastodonte d’acier. Au total, 57 tonnes de ferraille ont été soulevées pour s’envoler, dans un ballet aérien aussi puissant que délicat. Six pylônes du nouveau télésiège ont été posés et assemblés les uns après les autres, guidés par la main experte du pilote, et réceptionnés au centimètre près par les équipes au sol. Un jeu d’équilibriste entre la gravité, le vent, et la précision humaine. Héliporter en montagne, ce n’est pas juste voler. C’est sans doute l’activité la plus difficile du métier car ce savoir-faire exige une connaissance parfaite. L’altitude, la température, l’ensoleillement, l’aérologie très changeante d’un versant à l’autre, le type de charge : tout entre en ligne de compte. Quand l’air se réchauffe, la portance chute. Quand le vent se lève, la stabilité devient un combat.
Grâce à cette étape d’héliportage, le chantier a franchi une étape décisive. En une poignée d’heures, la combe de Gron s’est métamorphosée : des pylônes fièrement dressés marquent désormais le tracé à venir du futur télésiège. Impossible désormais de ne pas se projeter. D’autres pylônes seront posés prochainement, par des moyens terrestres cette fois. Leur accès plus facile permet d’éviter l’héliportage. Un choix volontaire, guidé autant par la maîtrise des coûts que par une volonté de limiter l’impact environnemental.
ÉTAPE 3 : CONSTRUCTION DES GARES
Avant d’assembler les éléments mécaniques des gares de départ et d’arrivée, la première tâche consiste à réaliser les fondations en béton, à commencer par la semelle de propreté. C’est une fine couche de béton coulée directement sur le sol pour garantir une surface plane, propre et stable avant d’accueillir les fondations principales. Celles-ci sont réalisées de manière classique, avec l’aide de cages ferraillées noyées dans le béton pour assurer la solidité et la résistance de l’ensemble. Il faut savoir que la qualité du béton utilisée ici surpasse largement celle d’une construction traditionnelle. Et pour cause : ce sont les gares qui supportent les forces générées par le mouvement du télésiège et qui absorbent les contraintes liées à la tension du câble. Avec cette pression constante, elles sont toujours attirées l’une vers l’autre.
Une fois les fondations coulées et durcies, la structure de la gare prend forme. Comme un squelette, elle sert de base pour l’installation du moteur électrique, du réducteur et des voies de traînage (autrement dit les rails sur lesquels les sièges circulent dans la gare). Puis, l’habillage de la gare est réalisé avec des toitures et du bardage, assurant à la fois la protection des équipements et l’esthétique finale. Ici, du fait du reconditionnement, les gares vont bénéficier du renouvellement de lames de bois. L’objectif ? Garantir une finition irréprochable, sans les signes du temps de la précédente vie du télésiège.
Lorsque ces travaux sont achevés, la transition se fait alors vers la phase électrique. L’installation des automatismes et des capteurs est une opération minutieuse. Les nouvelles gares du télésiège sont plus complexes car elles disposent des caractéristiques spécifiques d’une remontée mécanique débrayable, en comparaison au précédent télésiège fixe. Le besoin en matière de technologie est accru. Tout doit fonctionner de manière parfaitement synchronisée pour garantir une exploitation fluide, sans oublier un embarquement et un débarquement sécurisé des passagers – notamment grâce au ralentissement progressif de la vitesse du télésiège, évitant tout déséquilibre ou toute chute.
En tout, la construction de chaque gare nécessite environ 7 à 12 semaines. Tandis que la gare de départ reprend sa place d’origine, la nouvelle gare d’arrivée s’installe, elle, face au télésiège des Molliets (explications ci-dessus dans le paragraphe « Genèse du projet »).
ÉTAPE 4 : INSTALLATION DU NOUVEAU CÂBLE
Merci aux équipes du domaine skiable, de la STM Pugnat, de POMA et de Héliswiss.
Toute reproduction ou utilisation des photos est interdite sans l’accord préalable du titulaire des droits – @Office de Tourisme Les Carroz.
Nouveau télésiège VS ancien télésiège de Gron : le match
LES DONNÉES CHIFFRÉES POUR COMPARER
Technologie débrayable au lieu d’un télésiège à pinces fixes pour l’ancien.
6 places contre 4 places pour l’ancien.
5,5 m par seconde en vitesse d’exploitation contre 2,5 m par seconde auparavant.
3 minutes 36 secondes de temps de montée avec le nouveau télésiège contre 8 minutes avec l’ancien.
2600 personnes par heure en débit contre 2200 personnes par heure.
Nouveau télésiège mieux sécurisé pour les enfants.
Meilleure liaison ski sur les différents secteurs du domaine skiable.